Tous les articles de Sophie Chavoix
Retour en grâce du travail manuel : une réponse au manque de sens ?
Nous assistons aujourd’hui à de nombreuses et surprenantes reconversions : beaucoup de gens quittent des postes à responsabilité, aux dénominations grandiloquentes qui suffisent à attester de leur réussite, pour devenir plombier, ouvrir une boulangerie ou encore rentrer chez les Compagnons du devoir en charpenterie ! Alors que le travail intellectuel représente depuis des décennies la quintessence du savoir et de la réussite, au détriment du travail manuel qui, dès l’école, est considéré comme la voie de « garage » pour ceux qui ne sont pas scolaires, nous assistons à un renversement de situation. Le choix du travail manuel serait-il une réponse au manque de sens professionnel ? Pour répondre à cette question, retour sur un divorce qui a profondément atteint le sens du travail : celui de la pensée et de l'agir.
Un article de Sophie Chavoix

37% des salariés français envisagent une réorientation vers des métiers manuels
D'après un sondage réalisé par OpinionWay en 2022 pour L’Atelier des chefs, organisme de formation spécialisé dans « les métiers de la main et de l'humain », 37 % des salariés français envisagent de se réorienter vers des métiers manuels. Parmi ces personnes, 51 % ont moins de 35 ans et 35 % proviennent des catégories socio-professionnelles supérieures. Toujours selon l’étude, ce phénomène traduit un désir croissant de trouver un sens professionnel, remettant en question le concept d'une carrière linéaire et suscitant des doutes sur le modèle traditionnel du salariat. L’étude rapporte encore que les salariés envisageant une reconversion vers l'artisanat sont principalement motivés par la fierté de produire manuellement (30% des sondés).
La divergence du penser et du faire
Dans son livre Éloge du carburateur paru en février 2016, Matthew B. Crawford, brillant universitaire américain qui a démissionné d’un Think tank à Washington pour monter un garage de réparation de moto, nous explique que l’intellectuel est bien présent dans le travail manuel. Pour lui, c’est la séparation entre le faire et le penser qui peut être à l’origine de la perte de sens du travail en général.
Tout commence au début du XXe siècle. Le travail manuel change de nature après l’apparition de la chaîne de montage en 1913. Taylor est alors ingénieur en chef des usines Ford. Il met en place l’Organisation Scientifique du Travail (O.S.T.) qui repose sur trois principes : la parcellisation des tâches, la spécialisation des salariés, et la séparation des tâches de conception, d'exécution et de contrôle. Taylor écrit à ce sujet : « Toute forme de travail cérébral devrait être éliminée de l’atelier et recentrée au sein du département conception et planification ». Taylor sépare ainsi le travail intellectuel du travail manuel. Le travail intellectuel est confié aux ingénieurs du bureau d’études qui montrent le « one best way » : les gestes les plus optimaux sont sélectionnés, compilés, chronométrés. Le travail manuel quant à lui devient un simple travail d’exécution par les ouvriers qui sont dépossédés non seulement de leurs outils, généralement légués par leur père, mais aussi de leur savoir-faire. Ils n’ont plus qu’à répéter indéfiniment les mêmes tâches, sans aucune part de réflexion, conduisant à une absurdité génialement illustrée par Charlie Chaplin dans Les temps modernes.
Il n’y a plus de facteur de différenciation entre les ouvriers qui deviennent interchangeables. Ford profite de la baisse du coût du travail qui en résulte pour augmenter la productivité. Cette nouvelle organisation suscite d’énormes résistances qui poussent les ouvriers à aller à la concurrence dans une industrie en plein développement. A cette époque, Ford devait embaucher 900 salariés pour en garder 100. Alors il décide d’augmenter les salaires, ce qu’il finance par la hausse de la productivité. Il tue ainsi la concurrence en vidant de leur main d’œuvre les petits fabricants concurrents.
On assiste donc à une entrée en crise du travail avec cette première divergence entre faire et penser. L’ouvrier est « décérébré », écrit Crawford : il exécute ce que le bureau d’Études pense. Le travail manuel est vidé de sa substance.
Ceux qui pensent, les cols blancs, sont les héros aux mains propres qui font tourner l’entreprise, l’usine… La tendance s’accélère tout au long du XXe siècle, à tel point qu’à partir des années 80-90 aux États-Unis, les outils disparaissent des écoles, et avec eux les cours de technologie. Les enseignants préparent leurs élèves à être des « travailleurs de la connaissance ». Petit à petit nos économies modernes sont vidées de leurs industries qui sont délocalisées dans des pays à faible coût de main d’œuvre. En France, comme ailleurs, l’économie se « sur-tertiarise ». Les cabinets de conseil en tout genre se développent et attirent comme des aimants les jeunes diplômés. Le travail intellectuel est signe de réussite. L’ouvrier, l’artisan, tout comme l’agriculteur sont pris de haut. Ce n’est pas nouveau ! Dans son roman Les étoiles de Compostelle, paru en 1985, Henri Vincenot met dans la bouche d’un maître compagnon qui enseigne, au XIIIe siècle à son apprenti l’art de la construction d’une abbaye, les paroles suivantes :
Tout ce qui s’est fait de beau dans le monde est passé par la main, et le monde grec s’est effondré pour avoir méprisé ces mains-là. Platon dans Phèdre a proposé un classement des hommes : en haut de l’échelle, c’était le philosophe, sur le deuxième échelon c’était le roi, sur le troisième le politique, qui gère la cité et le reste était de la roupie de sansonnet, de la merde de coucou : le médecin, le poète et tout en bas, tout en bas l’artisan et le paysan. »
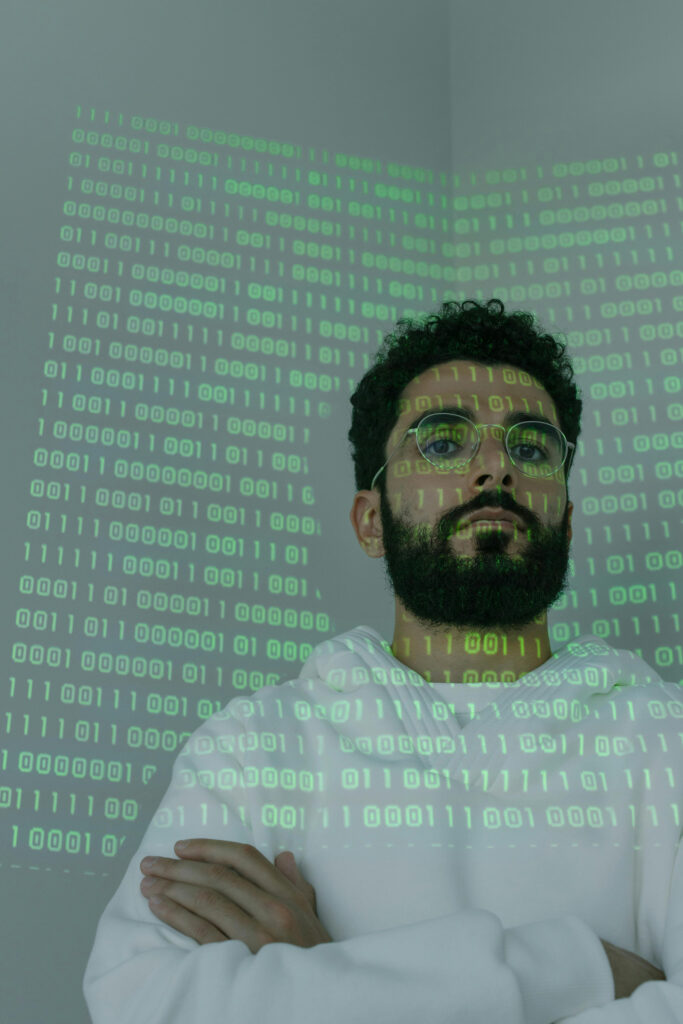
Mais à quoi ressemble le travail intellectuel des cols blancs aujourd’hui ? Il s’appuie sur des process, procédures, tableurs Excel… : dans ce type de travail, on manipule des abstractions en faisant tourner des algorithmes, et en appliquant des procédures. On est loin du penser. Penser, au contraire, c’est exercer son intelligence. Être intelligent devant la chose, et rendre la chose intelligente pour nous. Penser c’est aussi adapter les moyens disponibles à des fins posées. La pensée, « c’est l’art d’embrayer » (Crawford). C’est l’intelligence pratique, qui vient de métis (méthode) par opposition à l’intelligence logos (spéculative). Il faut trouver une solution et pour cela, être ingénieux, c’est-à-dire trouver le jugement appliqué à la situation pratique pour trouver une solution.
Crawford constate qu’il y a aujourd’hui dans de nombreux métiers une carence de pensée. Il est illusoire de croire que faire des tableaux, des « reportings » ou suivre des procédures laisse de la place à la réflexion. La divergence réapparaît, cette fois-ci entre penser et manier des algorithmes. La décision n’est plus issue d’une réflexion, mais d’un calcul. C’est au tour du travail intellectuel d’être vidé de sa substance.
Ce qui arrive aux cols blancs, explique Crawford, est issu du même processus que pour le travail manuel lors de la mise en place de l’O.S.T. Le travail intellectuel des cols blancs est en train d’être « décérébré » par les process, les procédures et les tableurs Excel. Les gens ne comprennent plus ce qu’ils font. D’où un sentiment de perte de sens généralisé.
En dehors des plombiers et des réparateurs de motos plus personne ne sait ce qu’il fait à proprement parler. » M. B. Crawford
La crise du sens
Nous l’avons vu, dès lors qu’il y a une séparation entre faire et penser (travail manuel), entre penser et manipuler des algorithmes (travail intellectuel), séparation issue de la conception taylorienne du travail, ce dernier perd tout son sens. Cette perte de sens trouve son origine dans un deuxième facteur.
Autrefois, le travail avait une dimension sacrificielle. Travailler, c’était s’inscrire dans une réalité socio-économique avec ses contraintes. La société avait besoin du travail des individus qui avaient eux-mêmes besoin de la société. Cela représentait un contrat social au milieu duquel se trouvait l’entreprise. Chacun assumait ses contraintes, même en souffrant, parce que le contrat permettait un jour de s’acheter une belle maison, avec un jardin, une voiture… Là se trouvait le sens du travail.
Mais le chômage de masse a remis ce contrat en question. Malgré ses sacrifices, l’individu n’est pas sûr de garder son emploi, et de pouvoir un jour acquérir la maison de ses rêves. Le contrat social est rompu. Dès lors, l’individu ne fait plus partie de la société mais il y fait face. Il ne s’intéresse plus qu’à ses droits et remet en cause l’autorité. Et il impose la valeur du consentement.
C’est pourquoi les entreprises doivent réenchanter le travail à tout prix, car elles ont en face d’elles des individus qui marchent au consentement. Il faut répondre donc à cette attente de sens.
Il faut que le travail ait un contenu éthique, et que les acteurs économiques se sentent personnellement engagés dans leur travail. » M. B. Crawford
Réenchanter le travail par le travail manuel ?
Le travail manuel est le travail qui opère sur une chose qui est à quelqu’un et dont il a besoin. Cette conscience du besoin est le cadre de l’engagement éthique. Lorsqu’un garagiste répare une moto, il sait que son propriétaire en a besoin. Son travail est utile et apportera une véritable satisfaction, voire de la joie à son client, qui se sera privé plusieurs jours de son mode de transport. C’est l’utilité d’un travail qui lui donne tout son sens.
De plus, le travail manuel vient réconcilier le penser (satisfaction de la solution) et le faire (créativité de l’agir). Il est composé d’habitudes (gestes réglés et répétés) et d’adaptation (capacité d’innovation et d’invention dans la réalité du problème). Il y a donc bien une composante intellectuelle dans tout travail manuel, hors de la logique taylorienne du travail bien entendu. En d’autres termes, quand le faire et le penser sont réunis, le travail manuel retrouve son sens.
J’ai toujours éprouvé un sentiment de créativité et de compétence beaucoup plus aigu dans l’exercice d’une tâche manuelle que dans bien des emplois officiellement définis comme travail intellectuel. » M. B. Crawford
Dans son livre Éloge du bricolage, Fanny Lederlin va encore plus loin en opposant la logique d’ingénieur au bricolage :
- La logique d’ingénieur, c’est la quête de productivité, d’efficacité donc d’optimum. Elle consiste à viser le plus court chemin qui va d’un point A à un point B, ou à calculer le plus grand profit pour un moindre coût par l’exécution de plans. Cette logique signifie que la « fin justifie les moyens » et que cette fin risque de remettre en question la liberté humaine. En effet, la logique d’ingénieur, aujourd’hui amplifiée par l’appareil algorithmique, empêchent les individus de penser : « En laissant insidieusement les algorithmes coloniser leur esprit et commander leurs actions, les hommes et les femmes du XXIe siècle pourraient finir par renoncer à exercer leur faculté de juger et par accepter des mesures liberticides. » selon Fanny Lederlin. Cette perte de liberté vient s’ajouter à la perte de sens, dont elle découle.
- Le bricolage, lui, est une rencontre pratique avec le réel : « Le bricolage se présente comme une tactique qui fait précéder la théorie par la pratique » explique Fanny Lederlin. D’ailleurs bricolage prend depuis la renaissance le sens de « moyen détourné, habile ». Il y a bien dans ce mot la notion de ruse, donc de pensée. Dans le bricolage, ce sont les moyens qui fixent la fin. Le bricolage est une démarche, manuelle qui engage le corps. « Il s’agit de percevoir, sentir, manier et ainsi rencontrer pratiquement des êtres vivants aussi bien que des choses. » ajoute-t-elle. Le bricoleur s’arrange avec « les moyens du bord ». C’est avec ce qu’il a à portée de main qu’il compose et coopère, pour mener à bien son projet. Il n’a pas recours au concept : il manipule les choses. Le bricoleur collectionne les rebuts, recycle les déchets, répare, et renonce à la perfection, limite le consumérisme (renonce au superflu), choisit le « ça va comme ça » à la place de l’optimum, se débrouille. Il redonne de l’utilité à l’inutile. Et permet aux êtres humains de (re)découvrir qu’ils sont dépendants les uns des autres et qu’il y a une liaison ombilicale qui les lie aux choses, autres êtres, aux situations. Il s’appuie sur des relations de réciprocité, d’entraide ou d’entente.
Le bricoleur est amateur, il est heureux, il est libre. » Fanny Lederlin
Conclusion
La perte de sens dans le travail est venue de la séparation entre le penser et le faire, et a été renforcé par l’apparition du chômage de masse. Le travail manuel, en tant qu’activité salarié ou en tant que loisir avec le bricolage, vient réconcilier le penser et le faire, la théorie et la pratique, ce qui pourrait se résumer par la phrase de Bergson :
Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action. »
Il est donc en cela une réponse au manque de sens, parce qu’il est complet et sollicite tout l’être. L’artisan se confronte au réel, cherche la solution au problème posé par l’observation, l’analyse, la déduction ; il s’engage physiquement dans la réparation ou la fabrication ; puis il gère son développement commercial, tout comme ses dossiers administratif et comptable. C’est le contraire de la « parcellisation des tâches ». C’est pour cela qu’il attire à lui tant de personnes, dont de nombreux cadres, spécialisés dans des tâches répétitives qui les brident, et dont ils ne comprennent pas toujours l’utilité et la finalité.
Ce retour aux métiers manuels devrait être renforcé par le développement de l’IA : 61 % des salariés pensent que l'IA (Sondage OpinionWay 2022) encouragera à opter pour des activités concrètes et manuelles. Nicolas Bergerault, co-fondateur de L’atelier des Chefs, a déclaré : « Les métiers de la main et de l'humain qui recrutent, permettent d'espérer de confortables revenus et ont besoin de bras que l’IA ne viendra pas remplacer. A-t-on déjà vu ChatGPT couper des cheveux ou préparer le dîner du soir ? »
Pour aller plus loin
-
Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur – Essai sur le sens et la valeur du travail (2016)
-
Fanny Lederlin, Éloge du bricolage – Souci des choses, soin des vivant et liberté d’agir (2024)
-
Henri Vincenot, Les Étoiles de Compostelle (1985)
Et si c'était le moment de retrouver du sens ?
Vous ressentez l’appel du concret, du manuel, d’un travail avec plus de sens ? Vous avez besoin de vérifier que cette reconversion est faite pour vous ?
Parlons-en lors d’un premier entretien offert : un espace pour nous parler de vos envies, poser vos questions et envisager une nouvelle trajectoire.
Pour bien s’orienter, une seule et vraie question !

Nous recevons beaucoup d’appels de parents qui sont affolés parce que leur enfant ne sait pas quelle décision prendre pour son orientation. Qu’il s’agisse de choisir les trois matières de spécialité en seconde, d’en enlever une en première, ou d’émettre des vœux sur Parcousup, point d’orgue de ce processus d’orientation en terminale, beaucoup se sentent démunis.
Pourtant, il faut se décider selon un calendrier très précis et aller vite. La pression est importante et source de tension en famille, alors que nos lycéens ont besoin de sérénité pour poser les bons choix.
Nous observons également que beaucoup d’entre eux sont obnubilés par leurs résultats : il faut avoir de bonnes notes, se constituer un dossier « vendeur », pour choisir une bonne filière sur Parcoursup et être pris.
Pour nous, il manque une question majeure, à laquelle il est primordial de répondre pour chacun : « qui suis-je ? Quel est mon talent : qu’est-ce que je fais avec plaisir, facilité et succès ? Qu’est ce que j’ai envie d’apporter au monde ? »
Faut-il incriminer Parcoursup ?
On aurait tendance à accuser Parcoursup de tous les maux. Pourtant c’est une plateforme qui a permis en 2023 à 917 000 candidats de choisir parmi 23 000 formations. 93,5 % des bacheliers ayant formulé des vœux ont reçu au moins une proposition d’admission et 76 % se sont déclarés satisfaits des réponses qu’ils ont reçues de la part des formations. Quant à ceux qui n’ont pas été admis en juillet, ils ont pu saisir la CAES (Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur) jusqu’à fin octobre.On peut donc dire que Parcoursup est un outil, ni plus ni moins, et que c’est un outil efficace qui remplit bien sa mission.
Les jeunes ont-t-il changé ?
Les jeunes ont une nouvelle vision du travail. Celui-ci doit avant tout leur permettre de bien gagner leur vie. Ils attendent de leur travail une bonne rémunération (43%), puis une activité intéressante (32%). Pour eux, le travail est un moyen de s’offrir une vie confortable, et du temps pour les loisirs. Ils ont souvent vu leurs parents s’épuiser avec des horaires élastiques, et ne souhaitent pas reproduire la même chose.
Après avoir fait l’exercice de présentations croisées auprès de classes de premières (chacun devait présenter son voisin/sa voisine selon un schéma précis, devant toute la classe), les élèves se sont exclamés, surpris et joyeux : « Nous vivons depuis plusieurs mois ensemble et nous ne nous connaissons pas ; il faudrait faire ça en début d’année… » Ils ne se connaissent pas entre eux, ils ne se connaissent pas eux-mêmes.
De plus, question métiers : la nouvelle génération a tout à réinventer. On ne connaît pas la majeure partie des métiers qui existeront en 2030 !
Alors, il n’est pas surprenant que nos jeunes se sentent un peu perdus… Michel Serre les appelle : « petit poucet » et « petite poucette » parce qu’ils écrivent des SMS très vite avec leurs deux pouces. Il écrit :
Un nouvel humain est né. Soyons indulgents, ce sont des mutants … » Et encore : « Ils ne parlent plus la même langue. [...] Cette immense différence, qui touche toutes les langues, tient, en partie, à la rupture entre les métiers des années cinquante et ceux d'aujourd'hui. Petite Poucette et son frère ne s'évertueront plus aux mêmes travaux. La langue a changé, le travail a muté. »
Nos jeunes jouent-ils leur vie dans ce long processus d’orientation ?
Alors qu’on leur demande de choisir toujours plus tôt leur métier futur, et qu’ils ont l’impression de « jouer leur avenir » à 15 ans, nos jeunes ont pourtant devant eux des possibilités infinies :
- Il y a tout d’abord un choix énorme de formations sur la plateforme Parcoursup
- Il existe aussi beaucoup de formations hors-Parcoursup, en France et à l’étranger (en Espagne et en Belgique pour les formations aux soins : dentaire, orthophonie…)
- Beaucoup de formations proposent désormais des rentrées décalées en janvier, voire même en mars,
- Il y a de nombreuses passerelles entre les formations : on peut changer sans repartir de zéro avec des équivalences. Un jeune qui n’est pas satisfait de sa formation, a 1001 façons de rebondir
- Il faut noter aussi que dès le lycée, il est possible de s’orienter vers les bacs technologiques et les bacs professionnels : est-ce qu’il faut s’entêter à faire passer nos enfants par la voie générale si on les sent fébriles dès la troisième ?
- Beaucoup de formations se font en apprentissage, dès la première année après le bac, pour ceux qui ont besoin de concret
- Faire une pause en prenant une année de césure est aujourd’hui bien vu sur un CV : cela permet de réfléchir, de mûrir, de s’offrir un temps d’intériorisation, d’introspection… En Angleterre l’année de césure est obligatoire après le bac.
- Enfin, pour ceux qui sont vraiment récalcitrants à toute idée d’études, la formation en continu (formation tout au long de la vie) se développe en France. Le principe repose sur un concept d’enseignement danois, la hhøjskole (ce qui signifie « haute école » en danois), créé au XIXe siècle par N.F.S. Grundvig, philosophe. Il est considéré comme le père de la formation tout au long de la vie. La højskole constitue l’une des particularités du système éducatif reconnue par le Ministère de l’Éducation du Danemark. Une école en France s’appuie sur ce concept : l'Année lumière.
- En outre, il est possible de rentrer dans la vie active par « la petite porte », puis procéder à la Validation des Acquis d’Expérience après quelques années (V.A.E.), et d’obtenir un diplôme reconnu.
Autant dire que les enfants ne jouent pas leur vie à 15-16-17 ans ! Quels que soient leurs choix, l’horizon reste très ouvert. Il y a de nombreuses manières de tracer son chemin, et une infinité de parcours différents.
Pour bien s'orienter, une seule et vraie question : « qui suis-je ? »
Il reste un point préoccupant : nos jeunes ne se connaissent pas. Ils avancent un peu aveuglément en répondant aux injonctions qu’on leur fait, sans se donner la possibilité de réfléchir en profondeur à ce qui les met en mouvement. Ils restent muets quand on leur demande de parler d’eux (sauf pour se trouver des défauts).
Bien sûr, il est nécessaire de les motiver à aller visiter des établissements supérieurs lors de journées portes ouvertes, à se rendre à des forums métiers, des salons d’orientation. Mais le rôle des parents est avant tout d’observer, d’écouter et d’encourager l’enfant. Souvent inquiets, ils ont peur de ne pas bien faire et sont sensibles au regard des autres, de la famille notamment. Mais ce qui est bon pour un enfant n’est pas l’idéal pour un autre. Chacun a un talent différent. C’est une bonne nouvelle parce qu’on a besoin de tous les talents pour construire une société. S’il n’y avait que des chirurgiens neurologiques ou des avocats d’affaires, le monde ne pourrait pas tourner ! Voyez ce qui se passe dans nos villes au bout de trois jours de grève des éboueurs !
Il est donc nécessaire de prendre le temps d’observer - et ça commence dès le plus jeune âge - comment les enfants se mettent en mouvement quand ils jouent par exemple. Tous les parents expérimentent que dans une même fratrie, chaque enfant, joue, agit et réagit de manière différente.
Le talent est inné. C’est une habileté naturelle, quelque chose que l’on fait avec facilité, plaisir et succès. Ce talent nous différencie des autres et constitue donc notre identité propre. Ce talent est tellement naturel à chacun, qu’il faut un regard extérieur pour pouvoir le reconnaître. C’est le regard des parents, des professeurs, des amis proches, des spécialistes de l’accompagnement.
Il est donc essentiel de reconnaître le talent de son enfant, de le lui expliquer, et de le valoriser.
Par ailleurs, les jeunes, bien qu’étant vulnérables dans ces périodes de questionnement, sont toujours pleins de générosité. Ils sont mus par l’envie d’être utile, et d’apporter leur contribution au monde. Il faut les aider à réfléchir à ce qui est important pour eux ; à la manière dont ils veulent servir le monde qui les entourent. Et essayer de ne pas étouffer leur désir, comme celui d’une jeune femme par exemple, qui annonce qu’elle souhaiterait être infirmière, et à qui on répond que dans la famille on est médecin ! Ils doivent avoir la certitude qu’il y a une place pour chacun d’eux, qui les attend, et où ils pourront se déployer pleinement, être heureux et rendre heureux.
Il est nécessaire pour cela de changer notre regard sur les métiers, les filières, de modifier notre angle de vue. Et de réfléchir à ce que nous souhaitons vraiment aux jeunes : qu’ils réussissent dans la vie, ou qu’ils réussissent leur vie ?
> En savoir plus sur notre Diagnostic de talents pour les lycéens et étudiants.
